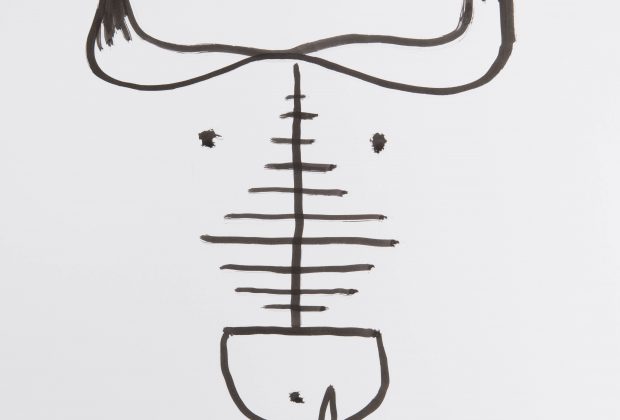par BENJAMIN FERRET / illustration CHARLIE TASTET
A Dax, la ville comme les habitants avaient retrouvé leur quotidien. Le cœur battant de la feria s’était tu jusqu’au mois d’août de l’année suivante, cédant sa place à ceux, plus apaisés, des curistes venus profiter des bienfaits des boues de la cité thermale. Ultimes palpitations d’un été en rémission, les trois jours de Toros y Salsa s’annonçaient dans le parc Théodore-Denis et les arènes. Le festival n’avait certes plus la superbe de ses jeunes années. Il continuait néanmoins de réunir, en un seul et même lieu, plusieurs milliers d’amateurs de danses latines, férus de tauromachie et autres fêtards nostalgiques. Comme nombre d’entre eux, Henri Lapeyre appréciait particulièrement cette deuxième fin de semaine de septembre. Beaucoup moins de monde qu’à la feria d’août, une fête concentrée dans le parc ; le commissaire qu’il demeurait jugeait ces éléments favorables à ce que le moment se passe sans incident. Il goûtait aussi à l’état d’esprit de la plupart des participants, décidés à se consoler ensemble, une dernière fois, avant de rentrer chacun dans un hiver qui serait long.
– Je comprends que vous ayez du mal à saisir ce qui nous attire dans ces moments. Patrick Espagnet l’avait écrit. C’était un poète des Landes de Gascogne qui œuvra comme journaliste. Permettez que je le cite. Je connais par cœur : « La fête du Sud-Ouest s’apprend pendant longtemps. Elle ne se donne pas d’emblée. Il faut l’amadouer, l’apprivoiser, la comprendre enfin pour mieux l’aimer. Parce qu’elle peut être odieuse et laide, vulgaire, empoisonnée de violence immédiate, de connerie indécrottable pour qui ne sait pas ou mal la faire ». Espagnet continuait en disant que les temps changeaient et – cela m’avait fait rire – qu’on pouvait « même lier des amitiés qui dureront ».
Installée à son bureau, Marianne Prigent écoutait distraitement Henri Lapeyre. Il tentait une nouvelle fois de lui expliquer l’âme de ces fêtes qu’il aimait tant. La magistrate venait de s’entretenir avec lui au sujet de l’activité du commissariat au cours des douze derniers mois. Même si elle détestait ce genre d’exercice, la procureure devait préparer son audience solennelle de rentrée, prévue en fin de semaine suivante. Marianne Prigent aurait alors face à elle tout ce que l’arrondissement de Dax compte de personnalités et d’officiels. Venaient-ils pour les discours ou le buffet qui suivrait ? Elle se le demandait à chaque rendez-vous du genre. Pour la magistrate comme pour le policier, l’assassinat d’Adolfo de la Caseria était, au fil des jours, passé d’une priorité absolue à une enquête à ne pas totalement abandonner. Les journalistes locaux étaient partis en congés avec leurs questions. Le sous-préfet lui-même n’avait pas demandé de nouvelles depuis que la procureure lui avait parlé de la cocaïne découverte dans la voiture de la victime. Comme le commissaire le lui avait conseillé, Marianne Prigent s’était gardée d’évoquer auprès du représentant de l’État les allégations de Juan de Salamanca sur le ministre de l’Intérieur espagnol. L’homme politique se trouvait d’ailleurs empêtré dans une polémique, née de la publication d’une enquête consacrée à Juan Carlos et la transition démocratique menée par l’ancien roi d’Espagne à la fin des années 1970. Indigné de ces travaux de recherches critiques et novateurs, le ministre s’était exprimé en direct sur Facebook en qualifiant les deux historiens auteurs de l’ouvrage de « révisionnistes ». Approuvés par une partie de la population, ce seul mot avait en retour suscité l’indignation du Movimiento 2Mil, à l’origine d’une pétition en ligne expliquant son soutien aux historiens mis en cause et demandant la démission du ministre. Le nom de Mar Albarracin était recensé parmi les centaines de milliers de signataires. Elle demeurait la seule trace de vie de la photographe trouvée par Marianne Prigent au cours de ses fouilles répétées sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches. Henri Lapeyre avait quant à lui confié la poursuite des investigations au capitaine Malatruse. Elles relevaient plus du domaine de l’administratif que de la recherche proprement dite. Des rapports à taper sur la mort d’Adolfo de la Caseria, des scellés à consigner, des analyses à intégrer dans des fichiers informatiques. Bref, des pistes à tenter de trouver avant même d’espérer les explorer. Ces timides efforts du policier dacquois restèrent sans retour jusqu’à ce début d’après-midi du vendredi de Toros y Salsa, lorsqu’il fit pépier le téléphone portable du commissaire.
– Qu’est-ce que tu me dis ?... Qui ça ? Un policier espagnol qui veut me causer... Au sujet de La Caseria ?... D’accord. Il est toujours en ligne ?... Transfère moi l’appel sur le téléphone fixe de Madame le procureure… Oui. C’est ça. Son bureau. Je suis avec elle.
Henri Lapeyre balaya l’écran de son iPhone et le rangea dans la poste de sa veste de coton beige. Assise en face de lui, Marianne Prigent avait tendu l’oreille et saisi le sens de la conversation. Le commissaire avait à peine commencé à lui expliquer ce que Malatruse venait de lui dire que, déjà, la sonnerie du téléphone de la magistrate se faisait entendre. La procureure appuya sur la touche main-libre du combiné.
– Commissaire Lapeyre ? Je suis le brigada Antonio Garcia, de la Guardia civil espagnole.
– Je vous écoute. Je suis en compagnie de Marianne Prigent, procureure de la République de Dax. Je comprends l’Espagnol.
– Et moi je parle le français parfaitement. Mon premier poste fut en Hondarribia, à la frontière, comme cabo. On m’appelait « Antouèèèèène », à la française. Maintenant je suis à Madrid. Je forme partie de l’EDOA, le service de lutte contre la délinquance organisée et le trafic de drogue.
Tout en regardant Marianne Prigent de deux yeux ronds comme des pièces d’un euro, le commissaire Lapeyre se retint de siffloter son admiration. Il invita d’une question le sous-officier à poursuivre :
– En quoi puis-je vous aider ?
– Avez-vous arrêté le tueur d’Adolfo de la Caseria ?
Dans le bureau de la procureure de la République, le silence se fit. Lourd et pesant. Il valait pour réponse. Si une mouche avait été dans les lieux à ce moment là, on l’aurait entendu vrombir. Marianne Prigent fronça les sourcils, en signe d’incompréhension. Elle imaginait le sous-officier en train de savourer ses effets de surprise.
– Le nom de Joaquin Molina vous dit-il quelque chose ?
– Rien du tout, brigada Garcia. Mais venez-en aux faits, réclama la procureure.
– Il vous faut être patiente, madame. Nous ne pouvons être certains de rien. A moins que vous ne soupçonniez déjà une personne… Et que mon appel ne vous intéresse pas ?
– Mais c’est vous qui…
– Oui. En effet. Je m’explique à vous. Ce Joaquin Molina, dont le nom ne vous parle pas, a été arrêté voilà quelques temps à Brunete…
Le commissaire Lapeyre interrompit le Guardia civil, la voix fière et assurée :
– C’est là où il y a eu des batailles pendant la guerre civile espagnole.
– Correct, commissaire. Bien. Continuons. Une patrouille a arrêté Joaquin Molina pour un excès de vitesse. Mais les Guardias ont vu de la drogue dans sa voiture. Il transportait plusieurs grammes de cocaïne... Elle a été analysée… Son ADN aussi et…
Ces derniers mots frappèrent un à un les esprits de Marianne Prigent et d’Henri Lapeyre comme autant de coups portés à un boxeur dans les cordes. Ceux de Walcott sur Jack Brennan dans la nouvelle d’Hemingway. Peu à peu, ils formèrent pourtant un écheveau d’idées que la magistrate saisit :
– Vous voulez dire que cette drogue est la même que celle que nous avons retrouvé auprès d’Adolfo de la Caseria ?
– Exactement ! C’est un résumé bon à faire.
– Et que vous a-t-il dit ? Il a été interrogé ? Pourquoi ne pas nous avoir prévenus plus tôt ?
– Je vous ai appelé dès que possible. Cela a pris du temps. Nos services ont d’abord vu que l’ADN de Joaquin Molina était enregistré dans les dossiers de l’Europole et de l’OCRTIS. Ils sont ensuite entrés en contact avec la Division des relations internationales de votre police pour pouvoir comparer notre cocaïne et la vôtre. Les résultats me sont revenus ce jour : c’est la même.
– Que dit Molina ?
– Jusqu’à ce moment, il n’avait pas dit grand-chose. Il a commencé par raconter avoir acheté la drogue sur une place de Madrid. L’histoire classique. Ensuite…
Le commissaire comprenait que leur interlocuteur comptait les mettre au supplice. Le brigada Garcia imposait son rythme. Il avait la main et ne comptait pas la lâcher, malgré l’insistance de la procureure :
– C’est aujourd’hui qui m’intéresse. Vous lui avez parlé des analyses ?
– Mais pour qui vous prenez-nous, madame la procureure ? Bien entendu. Il s’est montré perturbé. Dans un premier temps, il voulait rester dans le silence. Puis, face à l’insistance de nos enquêteurs, il a avoué avoir acheté sa cocaïne à La Caseria, chez vous à Dax, dans sa chambre d’hôtel…
– Et le meurtre ?
– Il nie formellement. Il dit qu’il a appris sa mort en arrivant aux arènes de Dax pour toréer. Il est sorti de France juste la novillada sans picador finie. Il jure ne rien avoir à voir dans cela…
– Cela ne prouve rien, sanctionna Marianne Prigent.
– Vous avez raison. Mais c’est là où ça devient étrange. Il nous propose un marché que je vous dois de présenter. Molina nous assure ne rien savoir de la mort de La Caseria mais avoir des informations importantes à fournir au sujet du trafic de drogue qu’il faisait. Il parle de plusieurs tonnes de cocaïne… D’un scandale national, « plus fort que celui d’Urdangarin ». Entendez-moi, nous sommes intéressés par en savoir plus… En Espagne aussi, les temps changent.
La procureure et le commissaire lâchèrent du regard le combiné téléphonique sur lequel s’était fixée leur attention. Sans avoir à se parler, ils réalisaient soudain où voulait en venir leur interlocuteur. Henri Lapeyre repensa à l’entretien qu’ils avaient eu avec Juan de Salamanca. Il se remémora ce que le matador leur avait laissé entendre au sujet des activités occultes autant que lucratives du ministre de l’Intérieur espagnol. Beaucoup plus pragmatique, Marianne Prigent se projeta et entrevit la rue sans issue dans laquelle fonçait le brigada Garcia, emportant avec lui tout espoir de clore de son côté l’instruction du dossier La Caseria :
– Vu les preuves scientifiques que vous avez par rapport à la mort d’Adolfo de la Caseria, la justice française que je représente va vouloir interroger votre homme au plus vite… Et risque fort de le mettre en examen.
– Il n’est pas transférable. Cela fait partie des conditions qu’il donne. Molina ne veut pas venir en France. Justement parce qu’il a peur d’être accusé à tort.
– Qui vous parle de venir ? Nous pouvons nous déplacer à Madrid ou lancer une Commission rogatoire internationale afin qu’un juge espagnol soit saisi et l’interroge.
– Cela prendra beaucoup de semaines, vous le savez.
– Vous allez aussi avoir besoin de temps, dit la procureure. Que vous-a-t-il dit raconté ?
– Molina veut des assurances écrites. Il a juste évoqué une planque dans un élevage de taureaux de lidia. C’est un renseignement qui nous a déjà été donné. Nous n’arrivions pas à l’exploiter. Pour nous, c’est une chance ce qu’il propose.
Tout en tendant la main ouverte en direction du commissaire afin que celui-ci garde le silence, la procureure se retint de dire au brigada qu’elle tenait à sa disposition les coordonnées GPS de la ganaderia du ministre de l’intérieur espagnol. Elle lui demanda en revanche un délai jusqu’au début de la semaine suivante, arguant qu’elle devait en référer à la Chancellerie, jouant de son simple statut de procureur de la République face à un dossier qu’elle jugeait trop grand pour elle. Une fois la conversation terminée, Marianne Prigent reprit avec Henri Lapeyre ce qu’ils venaient d’entendre. Ils décortiquèrent les éléments donnés par le sous-officier espagnol et les lièrent avec les leurs. Le hasard de l’arrestation de Joaquin Molina et ses conséquences leur paraissait digne d’un polar dont l’auteur ne se serait pas foulé pour sa conclusion. Ni l’un ni l’autre ne savaient finalement quoi faire, seulement qu’une décision devrait être prise. Poursuivre Joaquin Molina pour le meurtre d’Adolfo de la Caseria ? Oublier et le laisser aux mains de la Guardia civil espagnole pour qu’il dénonce le trafic mené par son beau-frère ministre, dans l’hypothèse qu’il en sache vraiment quelque chose ? Cela n’était de toute façon plus que la question d’un week-end, comme le suggéra le commissaire au bout de leur réflexion.
La fête de Toros y Salsa se passa. L’heure de la dernière corrida de la saison donnée dans arènes dacquoises approchait. Les martinets criaient et fouettaient l’Adour voisin. Le vent s’était levé. Les nuages bas avaient pris des lueurs d’océan. Le parc Théodore-Denis s’était animé dès la fin de matinée, des groupes buvaient l’apéritif au son de la musique salsa, d’autres déjeunaient et profitaient de l’ambiance. Henri Lapeyre et Marianne Prigent faisaient partie de la seconde catégorie. Face à l’insistance du commissaire, la procureure avait accepté de se joindre à lui pour manger une part de merlu sous le chapiteau du Lancer lourd dacquois. Le commissaire lui avait expliqué que les membres de cette association, à la fois pêcheurs et gourmets, servaient « un fish sans chips mais à la panure sans pareille ». Une fois terminée son assiette, la procureure dut reconnaître qu’il avait raison et confia même, au moment de se lever de table, n’avoir pas passé un aussi agréable moment depuis des semaines.
Il était maintenant dix-sept heures. Comme tous ceux qui s’apprêtaient à assister à la corrida, Henri Lapeyre et Marianne Prigent empruntèrent les allées de graviers qui vont aux arènes. D’individus, ils devinrent invisibles, fondus dans la masse. Son flux se déversait à travers l’une ou l’autre des portes de l’édifice, comme avalé par ce monument blanc et ocre toujours aussi coquet malgré ses cent ans dépassés. Ils approchaient de la fresque monumentale et mystérieuse sculptée dans le fer par Lydie Arickx. Henri Lapeyre vantait à qui voulait l’écouter les qualités des matadors engagés pour cette course. Marianne Prigent marchait à ses côtés. Avec sa haute stature, elle se sentait mal à l’aise, se déplaçant avec toujours la crainte de bousculer quelqu’un. Et soudain, ce fut une apparition. Quelques mètres devant elle, parmi tant de visages anonymes, Marianne Prigent reconnut celui de Mar Albarracin. Peut-être parce que la photographe ne s’était jamais manifestée depuis la feria, la procureure marqua un infime temps d’arrêt. Une hésitation. Un instant avant de fendre la foule pour essayer de la rejoindre. Une seconde de trop, puisque la magistrate ne parvint pas à la revoir avant de prendre place dans la tribune officielle, Mar derrière un burladero de la contrepiste, une partie du visage déjà masqué par le boîtier de son appareil photo. La musique de l’harmonie de la Nèhe comme les passes des toreros en piste ne parvinrent pas à capter l’attention de Marianne. Il n’était évidemment plus pour elle question d’Adolfo de la Caseria ni de la proposition faite par le brigada Antonio Garcia. Mais de Mar, en train de jouer de son appareil photo avec l’ombre et la lumière gaufrée d’une fin d’après-midi de septembre à Dax. Comment cette dernière était-elle parvenue à s’ancrer aussi vite dans son esprit ? Et y demeurer encore ? Marianne Prigent avait jusqu’alors, exclusivement et rarement, fréquenté des hommes. Tout avait commencé au troisième soir de la feria, dans une peña. Puis chez elle, une fois toutes les deux, avec du calva, la seule bouteille d’alcool que Marianne Prigent possédait. Des phrases et des rires lui revenaient à l’oreille. La trentenaire se souvenait avoir hésité à demander ses coordonnées à Mar. Des remords ? Non. Simplement un regret. Il s’effaça à la fin du cinquième taureau, « Marisquero », primée d’un tour de piste posthume juste après le commentaire du commissaire posté à ses côtés :
– « No hay quinto malo ». Et comme en espagnol, on dit « tinto » pour le vin rouge… Cela fonctionne aussi.
Derrière son burladero, Mar Albarracin finissait d’écrire un message qu’elle envoya sur le Smartphone de Marianne Prigent. La magistrate le lut. Il disait ceci : « Ma temporada s’arrête ce soir. J’en ai assez de ce mundillo et de la tauromachie. Je dois trouver une autre source d’inspiration... Je te dois une explication. Je ne t’ai pas tout dit sur La Caseria… J’ai réservé un appartement à Contis plage. Retrouvons-nous là-bas ce soir, c’est boulevard de la plage, numéro 342. ».
Le dernier taureau évacué vers les abattoirs en attendant de régaler quelques gourmands de ses quartiers, Marianne Prigent bouda toute conversation pour s’échapper des arènes jusqu’au palais de justice, d’où elle fila au volant de sa Peugeot électrique jusqu’à la station balnéaire de Contis. Elle en descendit ; il était 21 h 30. Elle entendit les portes de sa voiture se verrouiller alors qu’elle poussait le portail d’une maison de construction récente accrochée à la dune. Elle monta un escalier de pin au bout duquel un éclairage annonçait l’entrée des lieux. Elle posa son index sur la sonnette à droite de la porte d’entrée. Pas de réponse. Elle fit jouer la poignée et ne rencontra aucun verrou. Elle tomba face à l’Atlantique, posé dans la baie vitrée comme un écran de télévision accroché au mur d’un salon. Aux côtés d’une bougie à la flamme vive, une clef USB et une enveloppe avec son nom dessus trônaient sur la malle de voyage faisant ici office de table basse. Marianne Prigent voulut s’en approcher mais entendit soudain un bruit derrière elle. La procureure se retourna. Elle fut aveuglée un court instant par la lumière jaillie du phare. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut le sourire embarrassé d’Henri Lapeyre.
– Commissaire ? Mais… Que faites-vous là ?
– Je craignais que votre rendez-vous soit un traquenard.
– Comment ça ? Pourquoi ?
– La mort d’Adolfo de la Caseria...
La brise du mitan de la nuit approchant fit onduler le rideau accroché sur un côté de la baie vitrée. La procureure fit volte face, encore persuadée que Mar l’attendait.
– Il n’y a personne, Marianne. Je vous ai devancé ; cela sert de connaître les petites routes des Landes.
– Je ne comprends rien. De quoi me parlez-vous ? demanda Marianne Prigent. Tout s’emmêlait dans la tête de la procureure. Mar, Adolfo de la Caseria, Henri Lapeyre…
Avec une gravité inhabituelle chez lui, le commissaire raconta à la procureure de Dax la raison de sa présence en ce lieu. Les doutes qu’il nourrissait à l’encontre de Mar Albarracin étaient nés de l’étude des Smartphones connectés à la borne de l’hôtel Splendid au moment de la mort d’Adolfo de la Caseria. Un jeune brigadier de police zélé avait étudié la liste des communications recensées, convaincu que les enquêtes se résolvaient maintenant bien plus grâce aux données informatiques qu’aux témoignages de terrain. Ce fonctionnaire s’était notamment étonné des seize appels passés entre deux numéros de téléphone enregistrés chez un opérateur espagnol, dont l’un serait plus tard associé au nom de la photographe. Leurs durées n’avaient jamais dépassé trente secondes, exception faite de l’avant-dernier. Cet échange dépassait les quatre minutes et avait débuté deux minutes tout juste après l’heure de la mort de La Caseria définie par le légiste.
– L’un des deux numéros n’a plus jamais été utilisé par la suite, précisa Henri Lapeyre. L’autre appartient à Mar Albarracin et a intégré vos coordonnées dans son répertoire le matin du quatrième jour de la feria.
– Pourquoi ne m’avoir rien dit auparavant ?
– Je n’avais pas de raison de le faire. C’est votre vie privée, Marianne. Que Mar Albarracin soit au Splendid et téléphone au moment de l’assassinat de La Caseria ne prouve pas grand-chose. Mon brigadier m’a juste prévenu hier que son téléphone émettait à nouveau depuis Dax.
– C’est normal, rétorqua la magistrate. Mar Albarracin est là pour photographier les corridas de Toros y Salsa ! Et vous ne me dites toujours pas pourquoi vous êtes ici.
Une lame de couteau n’aurait réussi à fendre le silence qui pesait dans la pièce. Même le bruit de l’océan sembla s’absenter avant qu’Henri Lapeyre ne prenne la parole à nouveau. Le commissaire paraissait gêné.
– Jamais je n’aurais été là si mon brigadier ne m’avait pas convaincu de l’intérêt de fouiller à distance le Smartphone de Mar Albarracin... En quelques minutes, ce jeune a réussi à rentrer dans la boîte mail de Mar Albarracin et à trouver de curieux messages sur Adolfo de la Caseria… Ce métier n’est plus pour moi, Marianne. Je suis devenu obsolète avec mes méthodes d’une autre époque.
Marianne Prigent ne savait que dire. Aucun mot ne lui venait. La sidération qui l’avait envahi rappelait celle qu’elle ressentit un soir de novembre 2015. Henri Lapeyre lui apprit enfin que ce fonctionnaire de police féru de nouvelles technologies lui avait transmis une copie du dernier SMS de Mar alors qu’elle-même achevait de le lire.
– J’ai beau avoir du mal à réaliser qu’un numéro de téléphone et une adresse mail soient devenus des biens précieux pour n’importe quel individu, j’ai encore du pif. L’évocation de La Caseria et ce rendez-vous à Contis ne m’ont rien dit de bon ; c’est pour ça que je suis venu… J’ai eu peur pour vous.
Henri Lapeyre baissa le regard. Il s’inclina vers la malle de voyage pour s’emparer de l’enveloppe et de la clef USB. Il les tendit à Marianne Prigent et proposa de s’absenter un moment afin d’aller chercher son ordinateur portable, remisé depuis qu’on le lui avait donné dans le coffre de sa Renault. La magistrate accepta. Une fois seule, Marianne Prigent s’assit, ouvrit l’enveloppe et lu le texte qui débutait par son prénom, écrit à l’encre bleu marine : « Cela ne devait pas se passer comme cela. Adolfo de la Caseria ne devait pas mourir. J’aurais voulu pouvoir te raconter comment le Movimiento 2Mil a enquêté et réussi à le confondre, lui qui rédigea dans la nuit du 2 mars 1974 l’acte d’exécution de Salvador Puig Antich. Son nom ne te dira sûrement rien. C’était un jeune militant anarchiste. Il avait 23 ans quand il a été garroté. Le dernier à être assassiné de la sorte par le franquisme. Adolfo de la Caseria avait le même âge, il accomplissait alors son service militaire. D’Alicante, où il effectua sa période d’instruction et rencontra celui qui deviendrait plus tard son beau-frère tout puissant, il revint à Madrid. Les connaissances de sa mère comme son implication dans l’Organisation de la jeunesse espagnole firent de lui l’aide de camp de José Utrera Molina, ce ministre de Franco à qui La Caseria fit signer l’arrêt de mort de Puig Antich. »
Troublée de ces révélations, Marianne Prigent marqua une pause dans sa lecture. De retour dans l’appartement, Henri Lapeyre s’assit à côté de la procureure et alluma son ordinateur tout en écoutant cette dernière lui lire la lettre de Mar Albarracin. L’ouverture de la clef USB leur permit de découvrir trois documents. Un avis de décès de Puig Antich publié dans un périodique d’opposition au régime franquiste. Une copie de l’ordre d’exécution au nom de José Utrera Molina. Un carnet militaire daté de 1972 au nom d’Adolfo de la Caseria.
– Cela voudrait dire que La Caseria a été tué pour avoir été l’aide de camp d’un ministre franquiste ! S’exclama le commissaire Lapeyre. Il aurait été assassiné, non pas parce qu’il faisait chanter certaines personnes, non pas parce qu’il dealait de la cocaïne, mais parce qu’il avait contribué à la mort d’un opposant au régime…
Un résumé simpliste, comme le montra la suite des écrits de la photographe. « Oui, j’aurais aimé te raconter cette victoire de la vérité sur les heures grises du passé de mon pays, mais il n’en sera rien. Le camarade avec qui j’œuvrais n’a pas réussi à obtenir la dernière chose qui nous manquait : des aveux enregistrés. Il devait faire parler La Caseria tout en lui achetant de la drogue. Cet enfoiré de faciste était sous cocaïne, complètement paranoïaque. Il s’est douté de quelque-chose et s’en est pris à mon collègue. Ils en sont venus aux mains. Ils se sont battus. La Caseria voulait le tuer, mon camarade a été contraint de l’étrangler pour se défendre. Je ne peux te dire son nom, il est trop impliqué dans le Movimiento 2Mil. Ce mouvement ne doit pas être associé à un crime. Je peux juste te dire que Joaquin Molina n’a rien à voir dans ce dossier. Excuse-moi d’agir ainsi. Trop de choses nous séparent. Je ne peux pas affronter ton regard. Dans l’avenir, ailleurs, peut-être. »
– Qu’en pensez-vous, commissaire ? demanda Marianne Prigent, l’air abasourdie.
– Décidemment, Adolfo de la Caseria n’était pas du tout la personne qu’il voulait paraître... Nous avons enfin une explication à sa mort mais toujours pas de réel suspect. Elle disculpe même Molina… Peut-être devrions-nous lancer un avis de recherche international au nom de Mar Albarracin ?
– Vous avez sûrement raison, Henri. Mais peut-on vraiment en vouloir à quelqu’un d’avoir cherché à faire connaître le passé trouble de cet individu ? Je vais rappeler le brigada Garcia. Il aura peut-être plus de chance que nous dans la suite de cette histoire…
– Pour moi, vous faites bien, Marianne. Je crains que cela ne soit pas à la France de juger les morts d’Espagne. Et encore moins de fouiller dans un passé que les Espagnols ne veulent pas forcément voir.
Henri Lapeyre referma son ordinateur, mit la clé USB dans la poche de son blouson et montra la porte à la procureure.
– Rentrons. Avec un peu de chance, la bodega de la Peña taurine sera encore ouverte dans le parc des arènes…
FIN
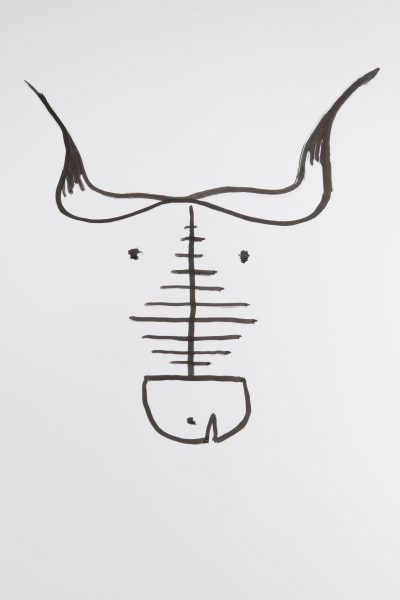
 L’auteur : Benjamin Ferret est journaliste au quotidien "Sud Ouest". Né en 1981 à Bayonne, il a passé ses premières années à Bidache, face au château des Grammont, à rêver des "Trois Mousquetaires" puis à vivre une adolescence entre rugby, tauromachie et littérature. Décidé à devenir enseignant, ses jeux d'enfant - quand il s'imaginait reporter - l'ont rattrapé. Lauréat en 2004 du prix "Revistero de demain" organisé par Semana Grande, il débute à "Sud Ouest" la même année avant d'être rattaché à la rédaction des Landes en 2009.
L’auteur : Benjamin Ferret est journaliste au quotidien "Sud Ouest". Né en 1981 à Bayonne, il a passé ses premières années à Bidache, face au château des Grammont, à rêver des "Trois Mousquetaires" puis à vivre une adolescence entre rugby, tauromachie et littérature. Décidé à devenir enseignant, ses jeux d'enfant - quand il s'imaginait reporter - l'ont rattrapé. Lauréat en 2004 du prix "Revistero de demain" organisé par Semana Grande, il débute à "Sud Ouest" la même année avant d'être rattaché à la rédaction des Landes en 2009.

Illustrations : Charlie Tastet, né en 1983, gascon de souche. La bohême taurine sera son école avant que la peinture ne s'impose. Depuis 2004, il a exposé en France, en Chine, au Portugal, et en Bolivie. Son atelier est désormais à Saint-Sever, cap de Gascogne.
ET POUR RETROUVER L'INTÉGRALITÉ DES ÉPISODES DU FEUILLETON DE L'ÉTÉ, CLIQUEZ ICI