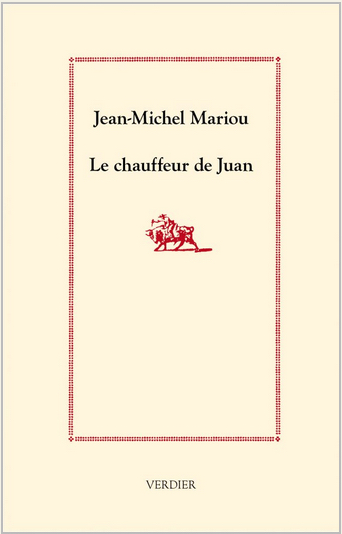« Souvent, j’ai porté en croupe un coq vivant dont je devais souper le soir »
Prosper Mérimée
1-Le chauffeur
Ce livre est né d’une scène ordinaire. Un dimanche de septembre, à 11h15 précises, je sors de ma chambre de l’hôtel Atria, à Nîmes, pour me rendre à la corrida du matin. C’est le dernier jour de la féria des vendanges, et rien ne presse. L’hôtel est situé à deux pas des arènes, et la corrida débute dans un quart d’heure. L’affiche est en sucre d’orge, comme c’est ici désormais la tradition matinale. Je sors donc de ma chambre, et remonte le long couloir silencieux. A travers les portes, aucun bruit ne filtre : tout le monde est déjà parti aux arènes. Arrivé devant l’ascenseur, j’appuie sur le bouton. Un long feulement, qui s’arrête dans un souffle, une petite sonnerie cristalline, et la porte s’ouvre devant moi. Je reste pétrifié devant la scène. A l’intérieur de l’ascenseur, trois hommes, immobiles comme les personnages d’un musée de cire. Habillé de lumières, le torero Morante de la Puebla, en costume gris clair son cousin et valet d’épée, le roux Juan Carlos, et Antonio Barrera, ancien matador et actuel représentant du torero, chemise blanche et costume sombre. Ils ont tous les trois les yeux rivés sur le sol. Aucun ne lève la tête vers moi. Pas le moindre geste ne vient troubler ce tableau irréel. J’hésite un quart de seconde : monter dans cette capsule spatiale sans être moi-même astronaute, cela relève à l’évidence de l’imposture. Mais les avoir fait stopper pour rien ?... Je me vois entrer dans l’ascenseur, je m’entends murmurer une formule de politesse. Personne ne répond. Les portes se referment. Toute l'oxygène a disparue, happée par les écharpes de peur qui reprennent possession de l’espace. De toutes façons, personne ne respire. Chacun tente ainsi d’étouffer son effroi. Chacun le sien. Celui du torero est sûrement différent des autres, mais pourquoi serait-il plus dense, plus fort ? Nous avons quatre étages à supporter. La chute est lente, interminable. Toujours pas le moindre souffle. Je me suis mis, immédiatement, à fixer le sol comme eux. L’idée est d’éviter que les regards ne se croisent : il serait insupportable d’y vérifier sa propre angoisse. Alors va pour le sol. Sans respirer. Finalement, la descente ralentit, l’ascenseur s’écrase doucement sur lui-même, la clochette retentit à nouveau, et les portes s’ouvrent comme le rideau d’un théâtre.
Brutalement, nous découvrons les dizaines d’aficionados massés devant les portes de l’ascenseur et qui attendent le torero, appareil photo ou simple téléphone portable dressé dans la main, comme une menace. Plus loin, le brouhaha de la foule, dans le hall de l’hôtel. Je m’échappe vivement, sans voir comment les statues se remettent à vivre, ou à faire semblant. Je contourne la foule et file vers la sortie. Des mères avec leur fille qui viennent tenter le selfie ; Des badauds qui cherchent l’image vernaculaire ; Des présidents de clubs taurins qui viennent vérifier là, et faire vérifier à leurs amis, qu’ils connaissent vraiment le héros du jour… Tout ce monde est là pour lui-même, pas pour le torero. Au bout du comptoir de l’accueil, la cuadrilla, capes d’apparat pliées sur les mains jointes, attend son torero pour lui emboiter le pas. J’arrive aux portes de l’hôtel, immense panneau de verre qui s’ouvre devant moi. Et là, tout change. Le son, la lumière, tout est différent. Le parvis de l’hôtel, écrasé par le soleil, est presque vide. J’aperçois la camionnette de Morante, qui attend, portières ouvertes. Et je le vois, lui, près d’elle, homme immobile, concentré sur sa cigarette. Personne ne fait attention à lui, ni à son regard, fixé sur les portes de verre. Je me suis arrêté pour l’observer. J’ai compris qu’à cette seconde, c’est l’homme le plus important du monde. Le chauffeur. En tauromachie, le voyage le plus terrible, c’est sûrement celui-là, le plus court, qui va de la chambre d’hôtel à l’arène. Le plus long. Lorsqu’on quitte sa chambre et, qu’avant de refermer la porte, on jette un coup d’œil circulaire – les rideaux bruns, la lithographie blette accrochée au mur au dessus du lit défait, les serviettes de toilettes roulées en boule sur le sol, la montre, le téléphone portable, le portefeuille posés sur la tablette – sur ce que l’on laisse et que l’on retrouvera peut-être, sûrement, trois heures plus tard, quand tout sera fini, d’une manière ou d’une autre, on n’éteint jamais aucune lumière, ni la télévision, qui va continuer vainement, dans le silence revenu, d’égrener ses feuilletons et ses jeux, jusqu’au retour de la petite troupe…
Le chauffeur est là, et il fume avec une grande application. A partir de maintenant, il doit tout faire à la perfection. Même fumer. Il va conduire la camionnette jusqu’aux arènes à travers la marée mouvante des retardataires, des touristes, des curieux. Quoi qu’il arrive, il sera à l’heure à bon port. Et c’est cette certitude seule qui dissipera la paralysante angoisse des uns et des autres. Le chemin s’ouvre, enfin, pour ce dernier voyage, minuscule, décisif.
C’est une évidence, la tauromachie est d’abord un voyage. La camionnette de Morante de la Puebla a parcouru cette année-là, d’arène en arène, la petite bagatelle de 14 930 Km. Et on ne compte pas les trajets pour se rendre aux entrainements, visiter des élevages et autres matinées de tientas. Ni bien sûr les deux voyages au Mexique qui s’effectuèrent, comme on peut l’imaginer, à l’aide d’un appareil de navigation aérienne. La saison, qui s’étire en Europe des Pâques jusqu’à Saint Lucas, fin octobre, est un long chemin ininterrompu marqué d’hôtels, toujours les mêmes, de restaurants nocturnes au bord des autoroutes, toujours les mêmes, d’arènes bouillantes, toujours les mêmes. Les trajets sont interminables, les visages interchangeables, les paroles d’encouragement répétées à l’infini. Mais qu’on ne s’y trompe pas : pour l’aficionado et pour le toro, c’est la même chose. Comme on le verra, il faut, pour réunir ces trois termes nécessaires à une corrida de toro, que chacun accepte le voyage…
Je n’ai jamais envisagé la corrida autrement : un déplacement de soi. Et pas seulement parce que notre passion nous entraîne de ville en ville, entre la France et l’Espagne. Le déplacement, en l’occurrence, est surtout symbolique. C’est qu’il faut d’abord sortir de soi pour être réceptif à ce monde qui vous bouscule. Voyager pour aller voir des corridas, ce n’est pas simplement multiplier les expériences de spectateurs. C’est accepter de se mettre en danger. Quitter ce monde ci, qui s’effondre, pour un autre, plus lumineux, qui vous aidera à réfléchir à votre vie, à votre destin, à la façon dont vous vous engagez. Sortir de soi, passer dans ce monde clos des toros où plus rien n’existe des rumeurs quotidiennes, mais pour en revenir plus fort, plus décidé, plus clairvoyant…
Extrait de Le Chauffeur de Juan, de Jean-Michel Mariou
livre à paraître le 14 mars 2019